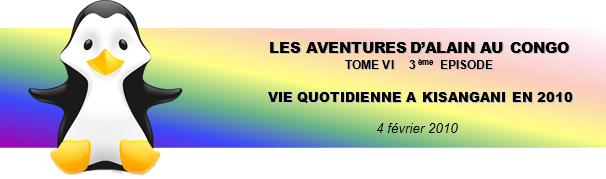- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Six heures trente du matin. Le ciel commence à se parer de rose au-dessus des hauts murs surmontés de tessons de bouteille et de fils de fer barbelés. Non, je ne suis pas dans la vieille prison de la ville de Kisangani ni à Guantanamo, mais dans la maison que j’occupe depuis le début du mois de janvier dans le quartier dit « des musiciens » en face du lycée Mapendano. Sécurité oblige. Je m’extirpe avec peine de mon lit, écartant la moustiquaire soutenue par quatre colonnes de bois, tel un baldaquin sommaire, qui m’a protégé des attaques des anophèles porteurs de malaria. Mon corps est moite de transpiration, car l’électricité est défaillante dans le quartier comme une nuit sur deux depuis mon installation. De quoi me rappeler que je suis ici pour réhabiliter le réseau électrique de la ville ! La climatisation n’a donc pas pu adoucir mon sommeil agité. Le thermomètre à affichage numérique indique déjà 29 degrés et 60 % d’humidité. La journée promet d’être étouffante à moins qu’une subite tornade tropicale ne vienne rafraîchir l’atmosphère.
Je me dirige vers la salle de bain, où ce matin l’eau s’écoule en un mince filet frais et vivifiant. Pour une fois, je ne devrai pas utiliser l’eau accumulée par précaution dans une touque en plastique de 50 litres pour pallier les défaillances de la société de distribution. Heureusement que cette eau est à la température ambiante, car le chauffe-eau électrique n’est évidemment pas alimenté. Mon vieux boy-cuisinier a pour mission de laisser couler l’eau en permanence — du moins quand elle coule — dans un seau qui lui permettra de remplir les réserves que ma compagne congolaise, prévoyante et connaissant les vicissitudes de son pays, a installées dans les deux douches et dans la cuisine. Par bonheur, l’eau est facilement stockable contrairement à l’électricité. Mais je dispose toujours à portée de main d’une torche électrique à LED, le dernier cri de la technologie moderne, rechargeable par une manivelle, pour me diriger dans la maison en cas d’interruption subite d’éclairage durant la soirée. D’autres sources de lumière autonomes, que j’ai eu la prudence d’acheter au Bricorama de Bruxelles avant mon départ, sont dispersées dans les différentes pièces de l’habitation. Je me suis même procuré une lampe de spéléologue qui, fixée sur mon front, me permet de lire dans mon lit ou d’utiliser mes deux mains en cas de besoin. À l’aube du 3ème millénaire, une installation au cœur du Congo se prépare encore comme il y a un siècle !
Ma puissante lampe de poche s’avère aussi fréquemment utile pour me diriger vers le poste de transformation situé au coin de la rue. Denis, mon collègue et voisin, un ancien responsable de la société de distribution de l’électricité, n’hésite pas à aller chercher chez lui, à proximité de nos habitations, un technicien de permanence qui va effectuer un bricolage sur notre départ de courant en cas de défaillance. Point besoin de clé pour entrer dans la cabine : sa vieille porte métallique non cadenassée permettrait à n’importe quel quidam d’y pénétrer et de s’électrocuter sur les arrivées en 6600 volts du transformateur. L’intervention ferait se dresser sur la tête les cheveux de tout électricien digne de ce nom : la majorité des lignes ne sont plus protégées par des fusibles, mais par des fils de cuivre tendus entre les mâchoires des porte-fusibles ! Certains rougeoient dans l’obscurité du local qui ne dispose évidemment plus d’éclairage. À de nombreuses occasions, les lignes aériennes surchargées d’épissures jouent le rôle de fusible et se rompent en dégageant des étincelles meurtrières ou mettent le feu au poteau en bois qui les supporte. D’autres, posées à même le sol et bricolées par les multiples fraudeurs, s’amorcent en arcs lumineux, tels les arcs électriques des soudeurs. Quel chantier et quelle inconscience !

Dès les premiers jours de mon installation, je me suis rendu chez le directeur régional de la SNEL, Société nationale d’électricité, ou devrais-je plutôt dire de la SNUL, digne ingénieur civil diplômé de l’université de Liège. Il n’est pas du tout affolé par la situation, rejetant la faute sur le manque de moyens et le peu de soutien matériel de son siège de Kinshasa. Je l’attaque immédiatement en sortant l’artillerie lourde : la coopération belge va dépenser 16 millions d’euros pour retaper sa centrale hydroélectrique et son réseau et il n’est pas capable d’alimenter correctement ma modeste maison. Il capitule, comme l’armée congolaise en rase campagne, et accepte sur-le-champ de me faire tirer une ligne particulière. Il donne par téléphone des instructions à ses collaborateurs… mais elles ne seront évidemment pas suivies d’effet. Denis, mon excellent et efficace collègue congolais, qui connaît tout le monde à Kisangani, prend les choses en main et réquisitionne hommes et matériels – que nous achetons chez le quincaillier libanais du coin et que je débiterai de ma facture de location. Il fallut quand même une semaine pour arriver à tirer 160 mètres de câble aérien préassemblé sur des poteaux de fortune. Sauvé, je vais pouvoir dormir confortablement à moins que le répartiteur de la centrale ne décide de délester le quartier. Mais j’ai son numéro de téléphone enregistré dans mon GSM pour pouvoir le rappeler à l’ordre le cas échéant. Quand je pense que certains de mes collègues du siège de la CTB envient la prime de pénibilité qui augmente mon salaire de base !
Petit déjeuner frugal et très africain : une papaye, une banane et un morceau de pain arrosés de thé que nous avions préparé la veille en chauffant l’eau sur un brasero et conservé dans un thermos. Je n’étais pas sûr de disposer d’électricité – et j’ai été bien avisé – pour faire fonctionner ma bouilloire à mon réveil. Après avoir récupéré mon voisin, me voilà en route vers les bureaux de la CTB logés dans le vieux bâtiment de la société de transit AMI-Congo. Malgré l’heure matinale, les rues sont déjà encombrées par des centaines de piétons, de vélos taxis, les fameux tolekas, et de mobylettes chinoises qui emmènent les enfants à l’école. Ils sont parfois juchés à trois ou quatre par engin au mépris des règles élémentaires de sécurité et ne portent évidemment pas de casque. Contrairement à Kinshasa, les artères de Kisangani ne sont pas embouteillées, mais je dois faire très attention aux motocyclettes qui me dépassent à toute allure par la droite ou par la gauche au péril de leur vie. C’est le paradis des deux-roues qui me rappelle vaguement Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Au premier carrefour, deux vélos se sont accrochés et la passagère, projetée sur la route en terre compactée, se relève en secouant son pagne pendant que les conducteurs s’invectivent. Plus de peur que de mal heureusement. D’autres vélos ou des pousse-pousse transportent des quantités phénoménales de denrées alimentaires vers le marché de la ville.

Je continue prudemment mon chemin au volant de mon pick-up double-cabine Toyota Hilux 4x4 en évitant le plus possible les excavations que l’Office des trous, pardon l’Office des routes, n’a pas rebouchées. Ici, pas besoin de ralentisseurs comme en Europe, les trous se chargeant de ralentir efficacement les véhicules ! Au deuxième carrefour, un policier en uniforme jaune préposé à la circulation, qualifié de roulage, me fait un signe qui signifie à la fois que je peux passer et qu’il attend de moi une petite contribution… Les conducteurs de motos taxis sont eux aussi régulièrement rackettés par les policiers qui doivent assurer leur pain quotidien malgré la hausse de leur salaire décidée récemment par l’Assemblée nationale : 1 000 francs congolais de plus par mois, soit même pas un euro. Une misère ! Les cadres des forces des Nations unies et des rares coopérations actives dans la capitale de la province Orientale, eux, se déplacent en 4x4 neufs importés depuis Kinshasa par voie aérienne. Comme ce fut le cas de ma voiture qui est arrivée un jour avant moi par un avion-cargo. Coût de l’opération : 4 700 dollars soit environ 3 250 euros. Seule alternative, le transport fluvial, mais j’aurais dû attendre au minimum un mois et je n’aurais pas été certain de récupérer mon véhicule avec ses pneus, ses essuie-glaces et ses rétroviseurs. Les autres voitures, en majorité de seconde main, proviennent du Kenya ou de l’Ouganda, voire du Japon, depuis que la route vers le Kivu a été réhabilitée par les Chinois. Elles sont aisément reconnaissables à leur volant situé à droite et aux autocollants publicitaires rédigés en japonais.
Passage chez mon propriétaire pour voir s’il a enfin ouvert un compte en banque pour que je puisse lui virer mon loyer mensuel. Ce monsieur, un des plus importants acheteurs de diamants de la ville, qui roule en Hummer à 100 000 dollars et possède plusieurs maisons à Kisangani, n’a même pas de compte dans une des rares banques de la ville. Toutes ses transactions se passent de la main à la main, en espèces, et sa fortune est dissimulée dans un énorme coffre-fort scellé dans le mur de son bureau. Et pourtant, la RAWBANK vient – publicité gratuite – d’ouvrir une splendide agence à côté du marché. Miracle, il y a même en façade un distributeur de billets qui accepte ma carte de banque belge de BNP Paribas – Fortis et me délivre à la demande les dollars nécessaires à ma survie quotidienne. Le progrès est en marche, mais les Congolais n’ont pas confiance dans leur système bancaire, car ils se sont fait spolier lors des banqueroutes des organismes financiers durant les guerres civiles. De plus, comme c’est le paradis de l’économie informelle et de la fraude fiscale, les rares entrepreneurs et commerçants craignent que leurs comptes ne soient bloqués par le fisc. Dans la troisième ville de la RDC, dont la population s’élève à 700 000 habitants, il n’y aurait pas plus de 500 comptes en banque, la plupart ouverts par les expatriés des ONG et de la MONUC. Malgré cela, les comptables qui gèrent la CTB voudraient que nous réglions toutes nos factures de plus de 400 euros par virement bancaire !
Arrivé au bureau, je commence ma journée en allumant mon ordinateur qui me permet d’être en contact avec le monde entier par Internet et même de parler à certains amis en Europe ou ailleurs grâce à Skype. Quelques heures plus tard, nouvelle coupure de courant due aux manœuvres de délestage. La centrale me rassure que cette manœuvre ne durera que quelques minutes. Donc pas la peine de mettre en route le groupe électrogène qui secourt nos installations. Comme promis, le secteur est vite rétabli, mais le bruit dégagé par le ballast de mon tube fluorescent me fait comprendre que la SNEL nous envoie du 380 V et non du 220 V. Je saute de mon fauteuil pour couper toutes les alimentations et avertir mes collègues, mais pas assez rapidement. Résultat des courses, un chargeur de GSM grillé et deux transformateurs de PC bousillés. Je me rends immédiatement vers la cabine qui nous alimente pour constater que celle-ci, ouverte à tous les vents, est transformée en dépôt par le réparateur de mobylette qui a installé son atelier sur le trottoir. Le technicien de la SNEL accouru à ma requête – je crois qu’ils commencent à me connaître en ville – se rend compte que notre départ est bien alimenté en 220 V, mais que le neutre de la ligne aérienne n’arrive plus à destination. Pas décontenancé, le technicien-bidouilleur de la compagnie d’électricité repère l’ancien câble pourri à isolation papier, vieux de plus de cinquante ans qui alimentait le bâtiment, et s’y repique pour trouver un neutre… Un bricolage provisoire en attendant que les spécialistes des lignes aériennes interviennent.
Ainsi va la vie à Kisangani, en ce début du XXIe siècle alors que le pays s’apprête à célébrer le cinquantenaire de son indépendance !
Suite au prochain numéro, si les Dieux de l'électricité me sont favorables...
Vers Tome VI - 2ème épisode <--- ---> Vers Tome VI - 4ème épisode